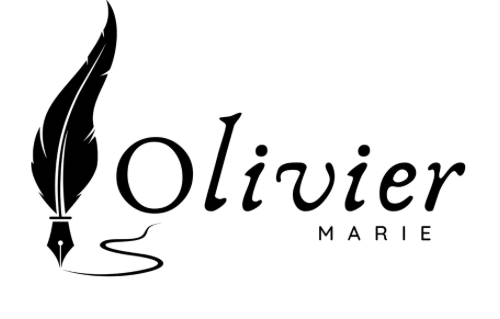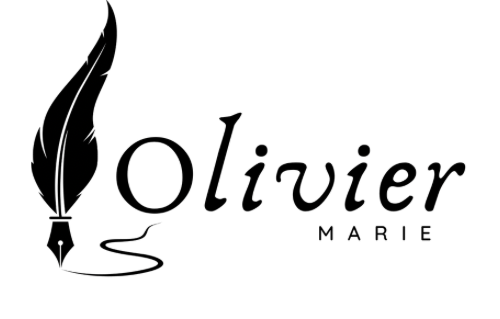Trop souvent négligé par les enseignants et les programmes car considéré comme auteur populaire (il est toujours surprenant d’ailleurs, de voir la sélection qui se fait dans les classiques autorisés, et jouissif d’exhumer les auteurs qui passent aux oubliettes de la pédagogie sous le prétexte surprenant qu’ils ont eu l’audace d’être aimés de leur temps, tel Mercier au XVIIIème ou Scribe au XIXème), René Barjavel, ainsi relégué à la science-fiction populaire offre pourtant des romans et des essais qui forment, à bien y regarder, une véritable cartographie anticipée de nos enfermements technologiques, politiques et mentaux. L’actualité virale autour du court métrage Télévision, l’œil de demain, réalisé par J. K. Raymond-Millet d’après un scénario et un commentaire de Barjavel, n’a fait que remettre en lumière une intuition plus vaste, plus profonde et plus dérangeante que le simple « smartphone avant l’heure ». Le film de 1947 montre des passants absorbés par leurs petites boîtes portatives, isolés dans la foule, reliés par des flux invisibles, informés en continu, disponibles à tout instant. Rien n’évoque encore les microprocesseurs, les réseaux numériques ou les bases de données planétaires, toutefois l’essentiel est déjà là, à savoir la capture de l’attention comme principe d’organisation sociale. Le regard se détourne de l’espace commun pour se fixer sur l’écran individuel, la relation directe recule au profit d’une médiation lumineuse permanente, le pouvoir cesse d’avoir besoin de se montrer puisqu’il circule désormais dans les images. Cette scène anodine de 1947 constitue, à bien des égards, l’un des premiers tableaux de la souveraineté confisquée par les dispositifs. Cette sourde dépossession, Barjavel l’avait déjà mise en fiction avec une brutalité visionnaire dans Ravage. La civilisation de 2052 qu’il y imagine repose entièrement sur l’électricité, les réseaux techniques, la mécanisation intégrale des besoins et des loisirs. L’effondrement soudain de l’énergie précipite la société dans la panique, l’exode, la violence, puis dans une forme de retour autoritaire à la terre sous couvert de salut collectif. La modernité s’y révèle fragile, non par excès de barbarie, mais par excès de dépendance. La promesse de confort absolu se retourne en vulnérabilité systémique. La technique, loin de libérer, devient la condition même de l’impuissance. Ce point est capital pour comprendre ce que j’ai tenté de décrire dans La Pensée confisquée. La domination contemporaine ne procède plus prioritairement par la censure, la répression ou l’interdit, mais par l’organisation silencieuse des cadres mentaux, par l’occupation constante de l’attention, par la saturation informationnelle qui rend toute pensée lente suspecte, toute distance critique impraticable, toute mémoire instable. Barjavel n’emploie pas ces mots, toutefois il en dessine déjà les structures. La technique moderne, chez lui, ne gouverne pas les corps par la force, elle gouverne les esprits par l’usage. L’anticipation des biotechnologies dans Ravage, à travers le fameux bifteck cultivé en cave, relève de la même logique. La question ne porte pas sur la faisabilité technique, aujourd’hui devenue banale avec la viande de laboratoire, elle porte sur la transformation du rapport au vivant. Le vivant cesse d’être un donné pour devenir un produit, un flux, une fabrication. La frontière entre nature et artifice se dissolve, ce qui n’est jamais neutre sur le plan anthropologique. La vie devient administrable. Cette mutation, au cœur de nos débats contemporains sur le transhumanisme et la bio-ingénierie, Barjavel l’avait déjà inscrite dans le décor d’une civilisation prétendument heureuse.
Le même geste se retrouve dans La Nuit des temps, où l’écrivain imagine la cryogénisation de deux êtres humains, la télévision mondiale en direct, la traduction automatique instantanée, l’identification généralisée, la monnaie dématérialisée par une bague électronique. Chacun de ces éléments, pris isolément, pourrait passer pour un simple jeu de l’imaginaire. Leur convergence dessine en réalité un monde intégralement appareillé, où l’existence sociale devient traçable, mesurable, monétisable, synchronisable. La technique n’y est plus un outil, elle devient un milieu total, pour reprendre un mot que Canguilhem n’aurait pas renié. Ce monde, saturé d’images, d’informations et de dispositifs, ne produit pas une humanité plus lucide, mais une humanité fascinée et politiquement impuissante. Le peuple de La Nuit des temps observe à la télévision l’exhumation d’une civilisation disparue sans parvenir à empêcher la reproduction de ses erreurs. L’information est parfaite, la compréhension demeure stérile. La connaissance ne se transforme plus en sagesse collective. Cette dissociation entre savoir et pouvoir d’agir constitue l’un des ressorts majeurs de la pensée confisquée. L’homme moderne sait, mais il ne décide plus. Il voit tout, mais il ne gouverne rien.
La même intuition traverse Le Grand Secret, où la découverte d’un virus rendant immortel conduit à un isolement sanitaire mondial tenu secret par les grandes puissances. Les chefs d’État conspirent au nom de la sauvegarde de l’humanité, les peuples ignorent ce qui se trame, la raison d’État biologique l’emporte sur la souveraineté populaire. Cette fiction, longtemps lue comme un pur délire romanesque, résonne aujourd’hui d’un écho singulier à l’ère des pandémies, des laboratoires P4, des traités sanitaires transnationaux et des décisions d’exception prises au nom du vivant. La santé devient un motif politique majeur, parfois au prix de la suspension durable du débat démocratique. La peur nucléaire, omniprésente chez Barjavel, de Le Diable l’emporte à Une rose au paradis, complète ce tableau. L’écrivain y décrit un monde où l’humanité accumule des armes capables d’anéantir la planète, où des élites se réfugient dans des abris automatisés en cas d’Apocalypse, où une dictature douce du bien-être dissimule mal la perspective de l’autodestruction. La technique promet la sécurité, elle engendre l’anéantissement absolu. Le progrès protège, puis il menace de tout effacer. Cette ambivalence n’est pas un paradoxe théorique, elle est la structure même de notre modernité. Loin d’annoncer seulement des gadgets, Barjavel décrit des conséquences. Il ne prédit pas le portable, il anticipe l’homme penché sur son écran. Il ne prophétise pas l’Internet, il décrit la capture de l’attention. Il n’imagine pas seulement la bombe, il dissèque la logique de la dissuasion suicidaire. Il n’invente pas la pandémie, il dévoile la gouvernance par l’exception sanitaire. Il ne fantasme pas la cryogénie, il interroge la dépossession du temps et du corps.
En cela, son œuvre entre en résonance directe avec mon essai sur la confiscation contemporaine de la pensée. Le pouvoir moderne ne s’impose plus contre les individus, il s’installe en eux, dans leurs habitudes perceptives, dans leurs gestes quotidiens, dans leurs prothèses numériques, dans leurs rythmes d’existence. La véritable aliénation n’est plus spectaculaire, elle est ergonomique. Elle est confortable, elle est plaisante, elle est fluide. Le génie sombre de Barjavel tient à ce qu’il avait compris, dès les années 1940, que la servitude à venir ne passerait plus par les chaînes visibles, mais par la douceur des usages. La société de la surveillance n’aurait pas besoin de miradors, de panoptique cher à Betnham, ni de télécran orwellien si chacun emporte volontairement son propre poste d’observation dans sa poche. La propagande n’aurait plus besoin de marteler des slogans si les flux d’images orientent d’eux-mêmes les peurs, les désirs et les colères. La censure n’aurait plus besoin d’interdire si l’attention est déjà occupée ailleurs.
Lire Barjavel aujourd’hui ne relève donc ni de la nostalgie ni du jeu rétrofuturiste. Il s’agit d’un exercice de lucidité. Ses fictions fonctionnent comme des avertisseurs, des dispositifs d’alerte à retardement. L’homme contemporain ne vit plus dans l’anticipation barjavélienne, il en habite l’accomplissement, avec cette particularité inquiétante qu’il continue de s’y croire libre. Ainsi s’esquisse, de Ravage à La Nuit des temps, du Grand Secret à Une rose au paradis, puis dans le discret Télévision, l’œil de demain, un même diagnostic, obstinément reconduit sous des formes diverses. La technique promet l’émancipation, mais elle prépare souvent la dépossession. Elle promet la maîtrise, mais elle engendre la dépendance, elle promet la communication, elle produit l’isolement de masse, elle promet la sécurité, elle fabrique l’angoisse globale. Donc, lire La Pensée confisquée, bien sûr, mais lisez Barjavel, tout autant qu’Orwell ou Huxley, il annonce les dérives de notre présent avec une clairvoyance étonnante. Comment faire comprendre à l’humanité que ces auteurs d’anticipation et de dystopies, tels P.K Dick, Asimov ou même Jules Verne ne nous ont pas livré des modes d’emploi mais des mises en garde ! La pensée confisquée commence peut-être là, dans cette capacité miraculeuse que nous avons inventée de vivre au cœur même de nos propres prédictions sans jamais les reconnaître comme telles.