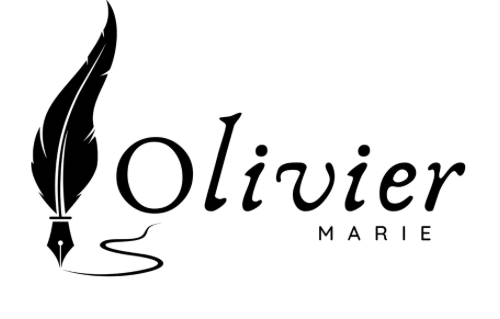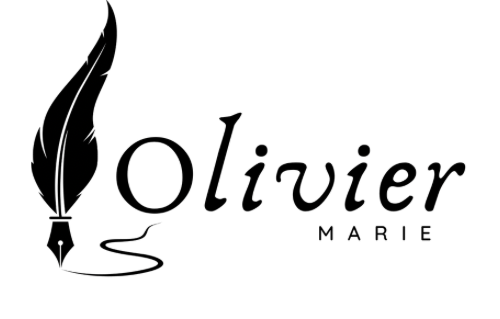L’histoire du XXᵉ siècle, relue à la lumière des analyses de Michel Corday, d’Annie Lacroix-Riz et de Johann Chapoutot, dévoile la constance d’une même logique : la guerre n’est pas un accident tragique de la civilisation, mais l’un de ses modes de fonctionnement. À travers les convulsions de 1914 et de 1939, les élites économiques et intellectuelles ont su transformer la peur, le chaos et la destruction en instruments de puissance. Ce qui s’était amorcé dans la fournaise des usines du Creusot ou de la Ruhr devint, quelques décennies plus tard, un système planétaire où la finance, l’industrie et la politique se fondirent dans une même rationalité de domination.
Dans Les Hauts Fourneaux, Corday en décrivait déjà les prémices : les banquiers finançaient la tension internationale, les industriels y voyaient l’occasion de faire tourner leurs machines, les gouvernements habillaient cette convergence d’intérêts du manteau sacré du patriotisme, et la presse se chargeait de transformer l’appât du gain en exaltation du devoir. La guerre, écrivait-il en substance, est une entreprise capitaliste dont les peuples sont la matière première. Michel Corday dévoile cette vérité nue : la guerre fut moins un affrontement entre peuples qu’une gigantesque opération de concentration du pouvoir au profit d’une élite financière et industrielle qui sut, dès avant 1914, transformer la peur en dividende, la ferveur patriotique en matière première, et la mort en source de rente. Les banquiers avaient compris, mieux que quiconque, que l’instabilité politique et la menace d’un conflit constituaient des moteurs d’investissement plus puissants que la paix. Les grandes maisons de crédit, Rothschild, Lazard, Paribas, la Deutsche Bank ou la Disconto-Gesellschaft, ne se bornaient pas à financer les États ; elles orchestraient les flux de capitaux qui permettaient aux arsenaux de croître, aux aciéries de s’étendre, aux chantiers navals d’enfler. L’argent, tel un métal en fusion, circulait de Berlin à Paris, de Londres à New York, liant entre elles des nations qui prétendaient se haïr, mais coopéraient silencieusement dans la fabrication du désastre. L’emprunt d’État devenait une forme raffinée d’asservissement collectif : les peuples, croyant défendre leur sol, se battaient pour rembourser leurs propres créanciers. Lorsque l’armistice vint, la paix ne fit qu’officialiser la victoire de cette oligarchie nouvelle. Les banques, enrichies par les emprunts, devinrent les maîtresses de la dette publique ; les industriels, récompensés par la reconstruction, transformèrent leurs usines en empires. L’État, endetté, dépendit désormais de leurs crédits, et le peuple, épuisé, dut leur fournir la main-d’œuvre bon marché d’un monde reconstruit sur les ruines. La guerre n’avait pas détruit l’ordre capitaliste : elle l’avait consolidé. Ainsi, sous le feu des canons, se forgea la structure moderne du pouvoir : une alliance entre la finance, l’industrie, la presse et la politique, capable de transformer le désastre en prospérité privée.
Deux décennies plus tard, les analyses d’Annie Lacroix-Riz ont révélé combien cette logique s’était prolongée jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Dans Le Choix de la défaite et Industriels et banquiers français sous l’Occupation, elle met au jour les complicités actives entre les grandes fortunes françaises et le régime hitlérien. Dès les années trente, une partie du patronat hexagonal, effrayée par les avancées sociales du Front populaire, préfère la victoire d’Hitler à celle du mouvement ouvrier. Les grandes banques, Paribas, la Banque de l’Indochine, la Société Générale, financent les échanges avec l’Allemagne nazie ; les entreprises sidérurgiques, textiles ou chimiques collaborent à la réorganisation économique du continent sous tutelle allemande. Il ne s’agit pas, selon Lacroix-Riz, d’une collaboration par contrainte, mais d’un choix idéologique et financier : celui d’une élite qui voit dans le fascisme un outil d’ordre et de profit. Johann Chapoutot, dans Les Irresponsables, éclaire le versant moral de ce même phénomène. Il montre comment les juristes, les cadres et les intellectuels du Reich ont élaboré une rationalité de la soumission : obéir n’était plus une faiblesse, mais un devoir ; penser n’était plus un acte critique, mais une compétence administrative. Cette logique bureaucratique, exportée puis recyclée après 1945 dans les grandes entreprises occidentales, a donné naissance à une culture de l’irresponsabilité où la décision se dissout dans la structure. L’individu n’est plus coupable, car il « ne fait que son travail ». Ainsi s’unit la machine économique dénoncée par Lacroix-Riz et la machine idéologique décrite par Chapoutot : deux faces d’une même modernité où la conscience se tait au profit de la performance.
Les États-Unis, après 1945, héritèrent de cet appareil et l’institutionnalisèrent. Le testament politique de Franklin D. Roosevelt, qui pressentait le péril d’une économie dépendante de la guerre, fut vite trahi par ses successeurs. Le président, dans ses derniers messages au Congrès, mettait en garde contre la tentation d’ériger le conflit en moteur de prospérité. L’avertissement demeura lettre morte. La guerre froide transforma l’effort militaire en colonne vertébrale du capitalisme américain : budgets d’armement, bases étrangères, interventions extérieures, tout concourut à maintenir la croissance par la tension. L’expression de « complexe militaro-industriel », reprise plus tard par Eisenhower, désignait moins une dérive qu’un système devenu structurel. Ce modèle s’est perpétué jusqu’à nos jours. Chaque crise internationale offre un nouveau souffle à cette économie de la peur. La guerre d’Ukraine en constitue la version contemporaine : les discours sur la liberté, la souveraineté ou la civilisation masquent mal les enjeux énergétiques et financiers qui se jouent dans l’ombre. L’explosion du prix du gaz, la reconfiguration des marchés pétroliers, la relance des industries d’armement, la spéculation sur les céréales et les métaux rares composent la symphonie familière d’une prospérité fondée sur la guerre. Les médias, fidèles à leur rôle historique, traduisent cette orchestration en récit moral : d’un côté la démocratie, de l’autre la barbarie. Le vieux couple rhétorique continue de servir de rideau de fumée à la circulation des capitaux.
Ainsi, du front de Verdun à celui du Donbass, des aciéries du Creusot aux consortiums pétroliers du XXIᵉ siècle, la même mécanique persiste : celle d’un monde où la guerre devient l’état normal de l’économie, où les élites se disculpent au nom de la nécessité, et où les peuples paient, génération après génération, les intérêts d’une dette qu’ils n’ont jamais contractée. Corday avait entrevu cette logique dès 1922. Lacroix-Riz en a retrouvé les archives, Chapoutot en a exposé la psychologie. Ensemble, ils dessinent le portrait d’une civilisation qui, ayant su rationaliser la guerre, a perdu le sens même de la paix.